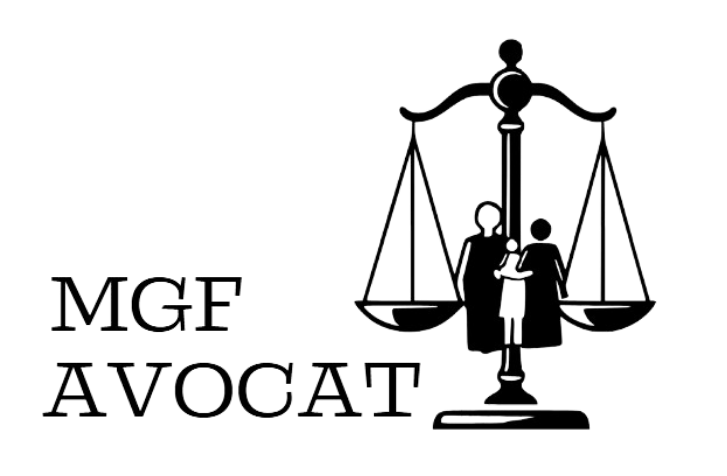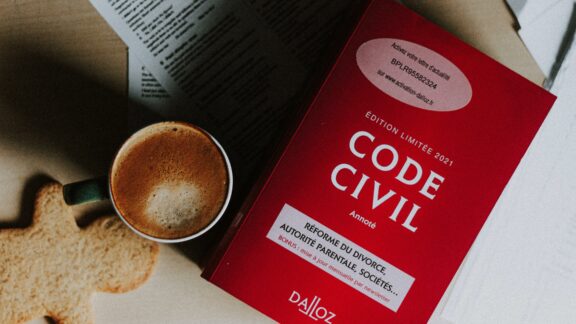Unlock your potential and take your business to the next level with our comprehensive course and actionable e-book.
Résumé : la Cour de cassation confirme le rejet d’une demande de droit de visite émanant d’une mère non statutaire, malgré l’établissement d’un projet parental commun à la naissance, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cour de cassation, 1re civ. 30 avril 2025 n° 23-11.544
Au sein d’un couple de femmes pacsées, un enfant est né en 2014 à la suite d’une AMP réalisée en Belgique.
A la suite de la séparation, deux en plus tard, la femme qui n’a pas porté l’enfant — et n’a donc aucun lien juridique de filiation —, soit « la mère non-statutaire », saisit le juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite et d’hébergement.
Par une ordonnance avant dire droit, le tribunal de Versailles ordonne la réalisation d’une enquête sociale. A titre provisoire, un droit de visite restreint lui est accordé.
Puis, à la suite de cette enquête sociale, le tribunal de Versailles rejette la demande de droit de visite et d’hébergement, soulignant une rivalité intense entre les ex-concubines. En outre, le rapport relève aussi un comportement dénigrant vis-à-vis de la mère légale, et le malaise croissant de l’enfant.
La cour d’appel de Versailles confirme ce jugement : les relations entre les deux femmes sont fortement dégradées, et l’enfant, âgée de 8 ans, refuse désormais tout contact. Selon la cour, raviver ce lien reviendrait à réactiver les conflits, au détriment de l’équilibre psychique de l’enfant.
La mère non statutaire forme alors un pourvoi en cassation, invoquant l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, estimant que la cour d’appel n’avait pas suffisamment mis en balance les droits en présence.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que les juges ont correctement apprécié les intérêts concurrents, en tenant compte à la fois du projet parental initial, des liens affectifs passés, mais surtout du refus actuel de l’enfant et de la toxicité du conflit parental.
Cette décision illustre la difficulté, pour les mères sociales non reconnues juridiquement, de maintenir un lien après une séparation.
Tant que la filiation n’est pas établie, les juges du fond doivent apprécier la demande comme celle d’un tiers au sens de l’article 371-4 du Code civil, en se basant sur l’intérêt de l’enfant.
En ce sens, la Cour de cassation s’appuie sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Callamand c/ France du 7 avr. 2022, n° 19511/16, § 38 et l’article 8 de la CESDH, en indiquant que :
« Le rejet d’une demande fondée sur ce texte, formée par une femme qui a construit avec la mère légale un projet parental commun sans que sa filiation soit juridiquement établie, étant susceptible d’avoir des conséquences radicales sur le droit au respect de la vie privée et familiale de celle-ci, en ce qu’il met fin à sa relation avec l’enfant, il appartient au juge, lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, de mettre en balance les intérêts éventuellement concurrents. Il doit, notamment, montrer par son raisonnement que les préoccupations relatives à l’intérêt supérieur de l’enfant sont d’une telle importance par rapport à l’intérêt du demandeur à au moins maintenir un contact avec celui-ci, qu’il est justifié, au titre de l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de rejeter intégralement cette demande. »
Cette décision illustre la grande vulnérabilité des mères sociales non reconnues juridiquement. Faute d’adoption ou d’établissement de filiation, elles ne peuvent agir que comme des tiers au sens de l’article 371-4 du Code civil – ce qui limite sévèrement la protection de leur lien avec l’enfant.
Elle révèle aussi l’impact destructeur des délais judiciaires : entre la séparation en 2016 et l’arrêt de la Cour de cassation en 2025, l’enfant a grandi sans aucun cadre légal de relation avec sa deuxième mère. Ce vide juridique a contribué à la rupture progressive du lien, que le droit, en l’état, ne sait ni prévenir ni réparer.